Ex-Libris. Armand de Pontmartin : un écrivain légitimiste maudit, chantre de la province

« [C]e n’est pas par les efforts de leurs partisans que les révolutions réussissent, mais par les fautes de leurs ennemis. Maxime commode qui assure les profits, en écartant les périls. »
Aux yeux de la bien-pensance culturelle, Armand Ferrard, comte de Pontmartin, cumulait tous les défauts. Il était légitimiste intransigeant, provincial et, en tant que critique littéraire, peu intimidé quand il s’agissait de s’attaquer aux « géants » du moment, en l’occurrence le XIXe siècle. Ajoutez à cela un caractère très sûr de lui-même qui le rendait imperméable aux intimidations culpabilisantes propres aux méthodes révolutionnaires et libérales. Un bel ensemble, somme toute, pour le rendre insupportable à beaucoup…
C’est ainsi qu’il fut un virulent opposant de Balzac, et qu’un Zola ou un Bloy n’ont eu aucune pitié posthume à son égard.
Et pourtant, il y a bien des choses à savourer dans l’œuvre de Pontmartin, œuvre qui ne s’est pas limitée à du journalisme. C’est notamment dans ses Contes et rêveries d’un planteur de choux — rééditées en 2022 par les éditions du Drapeau blanc — qu’il donne libre cours à sa plume dans divers genres littéraires. Avec une note morale dominante, mais sans moraline ni mièvrerie (au contraire, le devoir prend souvent l’allure de la sévérité la plus rude), il y propose un roman de mœurs (Napoléon Potard), un petit roman épistolaire très réussi (Marguerite Vidal), des nouvelles (Les Trois Veuves ; Le bouquet de marguerites) et des billets de style badin (Silhouettes d’artistes en province). Les lecteurs ressortent grandis et ennoblis de ces pages faites pour élever.
C’est dans les articles de fin, les « Silhouettes d’artistes en province », bien drôlatiques, qu’Armand de Pontmartin se permet spécialement de rendre à certains « Parisiens » qui méprisent les provinciaux, le dédain que lesdits provinciaux sont en droit de leur opposer. On appréciera ses talents sarcastiques (exemple, p. 330 de la réédition de l’année dernière : « Le gendarme, fidèle à ses attributions, ne comprenait pas » ; ou encore, p. 291 : « La police a mis six mois, un an, quelquefois plus, à s’apercevoir que la pièce blessait la morale. Que voulez-vous faire ? La police et la morale mettent toujours beaucoup de temps à faire connaissance ! ») :
« Grâce donc aux voyageurs et aux journalistes, qui, comme chacun sait, ne racontent que ce qu’ils ont vu et ne parlent que de ce qu’ils connaissent, nous pouvons avoir sur tous les points du globe des renseignements précis. Un seul pays est excepté de cette attention, de cette étude, de cette bienveillance générale : c’est tout simplement cette contrée sauvage et inconnue qui s’étend de Quimper à Fréjus et de Bayonne à Thionville ; ce sont ces grandes steppes intellectuelles, sociales, politiques, financières et artistiques qu’on nomme la province. Il y a là trente-un millions et quelque cent mille être vivants que les géographes appellent âmes par politesse, et qui peuvent penser, parler et agir, sans qu’on s’informe jamais ni de leurs idées, ni de leurs actions, ni de leurs paroles. Si on leur donne des préfets, des magistrats, des gendarmes, c’est uniquement pour la forme, et pour qu’ils s’imaginent être administrés ; dans le fait, ils n’ont et ne peuvent avoir qu’un fonctionnaire sérieux, le percepteur ; car, tout en s’occupant très peu de ce qu’ils veulent, de ce qu’ils disent ou de ce qu’ils font, on s’occupe très fort de ce qu’ils paient. Sous ce rapport même leur importance s’accroît à mesure que leurs charges augmentent, et plus le gouvernement auquel ils ont affaire est intéressé, plus ils deviennent intéressants » (Contes et rêveries…, p. 297-298 de la réédition de 2022).
Une exception néanmoins : le crime ! Que surgisse un beau tueur en série, un parfait assassin ou autre, et les journaux de Paris de tourner leurs regards vers tel ou tel recoin obscur du pays… Un tremplin de popularité qui n’est pas sans inciter au crime les faibles esprits en quête de notoriété…
Et plus loin :
« Dans un temps où tout le monde se pose, se drape, se grandit, s’exagère, fait le beau, l’éloquent, le brave, monte sur un piédestal ou sur des échasses ; où le charlatanisme est le roi du monde, où le gouvernement est un programme, l’industrie un prospectus, la littérature une réclame, le théâtre une affiche, le commerce une annonce ! Eh bien ! vous aurez aussi le charlatanisme du crime, les fanfares et les trombones de cours d’assises » (ibid., p. 300).
Pontmartin déplore que la frontière entre ces couvertures médiatiques et les romans de son époque, corrompus et corrupteurs, soit des plus floues :
« La voilà bien, cette folle et ridicule manie qui fait le fond de tant d’Indianas et de Valentines, et qui, en déplaçant les notions du devoir, en corrompt le sentiment, met l’humiliation là où devrait être l’honneur, l’honneur là où est la honte, prête une espèce de morale à l’immoralité, une teinte d’immoralité à la morale, et inspirant à certains êtres exceptionnels trop de vertu pour être tout bonnement des hommes et des femmes, leur donne tout juste assez de grandeur pour être des monstres ! Ne reconnaissez-vous pas, dans ce dernier trait, le roman, le simplisme, la triste poétique que nous avons inventée, poussés à leur limite extrême et impitoyablement reproduits dans le plus humiliant des miroirs ? On a dit que la littérature était l’expression de la société ; cette fois la société et la littérature se sont si bien alliées, qu’on ne sait plus où est la copie, où est le module » (ibid., p. 309).
On se souvient en effet de Bonald expliquant que la littérature est l’expression de la société. Son disciple Pontmartin s’inscrit dans la même veine, en dénonçant la décadence dix-neuviémiste à l’œuvre dans tous les domaines :
« Pour te conter une histoire de voleurs, il faudrait te faire toute notre histoire politique, industrielle et morale, et celle-là ne t’amuserait pas ; elle est déjà bien assez triste pour nous, vieux enfants, qui sommes forcés de la savoir ! » (ibid., p. 286).
Les Trois Veuves
La courte nouvelle « Les Trois Veuves » est peut-être l’une des plus dures, mais où la primauté du devoir resplendit avec le plus d’éclat.
N’attendez pas du faste, du fantasque ni du fantastique, mais uniquement de la vérité :
« Cette vie, comme toute vie d’immolation, avait ses austères et merveilleuses douceurs. La religion, cette sœur aînée du cœur de l’homme, n’a-t-elle pas répondu à ce mystérieux attrait, lorsqu’elle a fondé sur le sacrifice ses dogmes divins et consolants ? » (ibid., p. 233).
Napoléon Potard
Ce qu’Armand de Pontmartin exècre le plus, c’est le libéralisme orléaniste, l’embourgeoisement capitaliste, si bien qu’il est encore capable de saluer l’héroïsme soldatesque des vieux grognards bonapartistes, qui se sont simplement trompés de cause et qui pourraient venir se fondre dans les rangs sains de la Légitimité. Cela ne l’empêche guère d’être quelque peu moqueur et critique des mouvances qui, sous la Restauration et la monarchie de Juillet, regrettaient le Buonaparte.
Napoléon Potard, héros du petit roman éponyme, se découvre ainsi des origines et une existence hors du commun, malgré son nom pour le moins grotesque et oxymorique…
Ces pages sont l’occasion de mettre en présence plusieurs sociétés, pour en saluer une et pour en démasquer les autres. Les mœurs libérales du temps sont pourfendues, de même que leur littérature et « ce mauvais goût familier à un temps où on ne sait plus même faire d’élégantes sottises » (ibid., p. 15). C’est ainsi que Napoléon Potard en quête d’une carrière et de notoriété confie :
« — Alors, mon ami, après avoir essayé de ces chimères stériles, j’ai demandé asile à la plus séduisante de toutes, à la poésie ; j’ai terminé un drame et un volume de vers ; j’ai porté le tout à un directeur de théâtre et à un libraire : le directeur a refusé ma pièce, parce qu’il n’y avait, m’a-t-il dit, ni adultère, ni viol, ni cimetière, ni poison, ni inceste ; et le libraire a refusé mes vers, sous prétexte qu’ils n’étaient ni assez neufs, ni assez ridicules pour avoir du succès. Voilà où j’en suis de mon odyssée » (ibid., p. 94).
Et Armand de Pontmartin de se moquer à la fois de lui-même et des romans de ses contemporains, lançant tôt (p. 12) en tant que narrateur : « mais j’en reste là de ma description ; car outre qu’elle devient un peu verbeuse, je ne suis pas encore assez expert dans l’art du conteur pour adopter ce système de détails techniques qui fait de plusieurs chapitres de nos romans, des rapports d’anatomistes, des inventaires de marchandes de modes ou des mémoires de tapissiers. »
Le texte recèle de petites piques adroites et de remarques reprenant tel ou tel abus. En voici par exemple une pour les faiseurs d’opinion : « les gens assez naïfs pour se taire sur ce qu’ils ignorent, s’imaginent que l’on connaît ce dont on parle » (ibid., p. 56). Et encore une pour Isaac de Benserade, académicien juif du XVIIe siècle, largement oublié de nos jours : « Avec ses beaux cheveux crêpés, […] Bénédicte eût inspiré un sonnet de plus à Benserade, ou mieux encore, lui eût fait déchirer tous les autres » (ibid., p. 38). Sans parler de « cet esprit positif et calculateur que tant de Parisiennes savent allier aux plus gracieuses apparences » (ibid., p. 13), le poussant à préférer les provinciales (c’est d’ailleurs le thème de la dernière pièce du recueil que constituent les Contes et rêveries d’un planteur de choux).
Un auteur maudit à redécouvrir avec d’autant plus d’avidité.
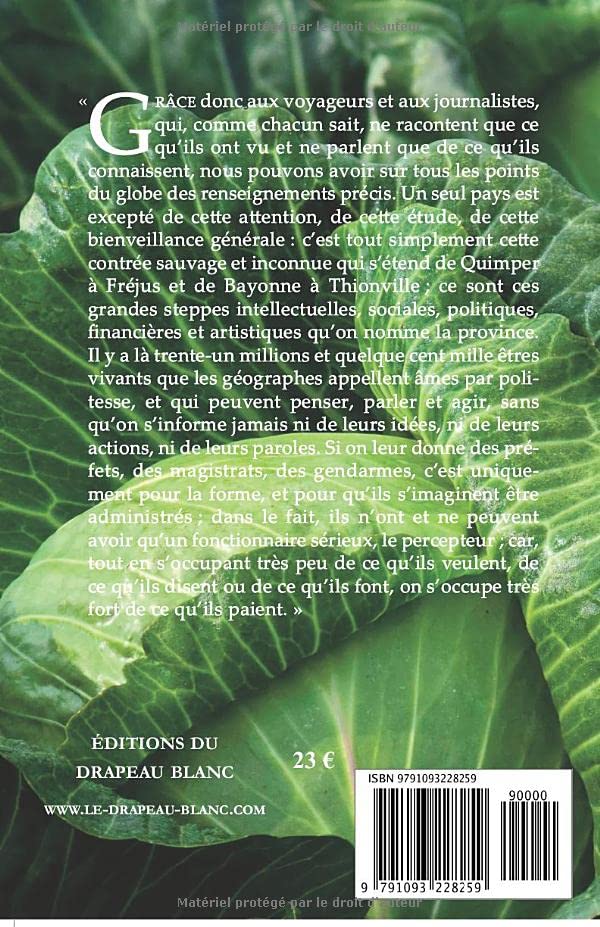

Ping : Vexilla Galliæ fait redécouvrir Pontmartin et ses « Contes et rêveries » – Éditions du Drapeau blanc