Ex-libris. « Un procès à Edo », par Satoshi Takahashi
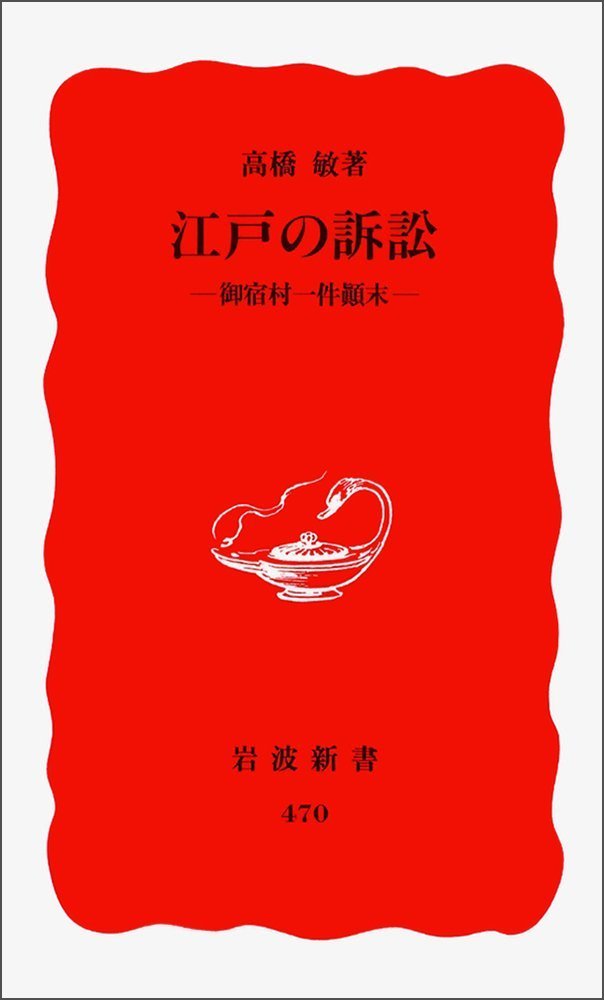 Satoshi Takahashi, 江戸の訴訟 (« Un procès à Edo »), Iwanami, Tokyo, 1996 (rééd. 2010).
Satoshi Takahashi, 江戸の訴訟 (« Un procès à Edo »), Iwanami, Tokyo, 1996 (rééd. 2010).
Cet ouvrage est une étude de cas d’une affaire particulière, bien connue des sources de l’époque, s’étalant entre 1849 (année de l’affaire) et 1853 (fin du procès). Le livre nous décrit, en filigrane, la vie d’un village rural japonais du XIXe siècle, ainsi que le fonctionnement d’Edo, la capitale nippone. L’étude de cas prend place à la toute fin de l’ère Edo, dans un contexte de longue paix et de situation pénale plus « souple » que dans la première moitié d’Edo, très dure, voire cruelle.
Note pour les japonisants : le japonais de ce livre est très agréable à lire, le style littéraire appréciable et bien en phase avec le sujet du livre. Il se distingue de trop de livres universitaires japonais qui se complaisent à user d’un jargon ennuyeux et de tournures grammaticales arides.
Sommaire et résumé par chapitre
Chapitre 1 : Émergence de l’affaire
L’affaire en question concerne un assassinat qui a lieu en 1849 au village de Mishukumura, à l’extrême est de la plaine s’étendant au pied du mont Fuji, en marge de la grande artère de circulation « Tokkaidô ».
Le 21 août 1849, un groupe d’hommes armés de lances, de fusils et de longs sabres s’introduisent chez Gensaemon et assassinent le vagabond Sozô qui est illégalement logé là contre de l’argent — il entretient des relations interlopes et mal connues avec la maisonnée. Il reste certain que Gensaemon tient une échoppe clandestine pour voyageurs et, régulièrement, embauche illégalement des vagabonds comme journaliers. Ce Sôzô, lui-même membre d’un réseau crapuleux de jeux d’argent et de trafic illégal, doit avoir une relation de ce type avec Gensaemon : au moment de l’affaire, le père de Gensaemon, Eisaemon, n’est pas là, ni sa mère. Gensaemon s’en va se cacher et son frère, cherchant sa mère, est blessé. Le groupe de bandits est composé de douze ou treize assaillants, tous membres de la bande de vagabonds de Kyuhachi. C’est un règlement de compte entre réseaux crapuleux — ils ont beau être vagabonds, ils n’étaient pas pauvres, vagabond signifie ici simplement qu’ils n’ont pas d’existence légal, qu’ils sont exclus de la société habituelle, ostracisés.
Le mort, étranger au village donc, reste sur les bras de la famille Gensaemon, qui décide de l’enterrer dans un temple abandonné, pendant la nuit, à l’insu de tous. Le village subit une inspection du seigneur depuis trois jours (depuis le 18 août), et tout le monde est affairé quand l’assassinat a lieu (logement de plus de 80 personnes dans ce village de moins de 300 personnes). L’inspection ne quitte le village que le 30 août.
Le village et la famille sont donc terrifiés, car la loi prévoit une forte punition pécuniaire pour qui tenterait d’enterrer le cadavre d’une victime d’assassinat sans en informer les autorités, mais, plus que cela, la loi prévoit de punir sévèrement toute personne qui loge un vagabond, et selon la lettre de cette loi, le logeur autant que sa famille, voire le village entier, peut risquer très gros. Le village se concerte alors pour étouffer l’affaire, avec l’accord du seigneur local, et le laisser enterré sine die.
Notons ici la terreur du village entier, qui risque de subir les foudres des autorités par simple ricochet, pour une simple affaire de logement d’un vagabond hors-la-loi : l’assassinat lui-même est secondaire, il ne fait qu’attirer l’attention sur le logement illégal, et personne ne cherche à entreprendre une enquête qui, pourtant, aurait pu permettre la poursuite du groupe de bandits (cela n’effleure personne, à aucun moment !). La vie ne compte pas. Il n’y a pas non plus de « non-assistance à personne en danger ».
Alors, on étouffe l’affaire. Chose intéressante : l’étouffement se fait avec formalisme. Les différents chargés locaux et responsables produisent deux certificats pour se dédouaner de toute responsabilité, au cas où : le premier certificat proviendrait d’un « familier de l’assassiné » reconnaissant avoir pris le corps (ce qui est un mensonge) ; l’autre certificat, signé par le logeur Gensaemon, pose toutes les responsabilités sur les épaules de ce dernier. Celui-ci, de plus, est officiellement expulsé du village (en fait, on constate officiellement qu’il est « en fuite et disparu », faisant ainsi disparaître la personne supposément responsable de l’affaire) et sa famille condamnée à une peine d’isolement d’une semaine.
En bref, tout le monde s’arrange, quitte à mentir, quitte à produire de faux documents, pour étouffer l’affaire et se protéger au cas où les autorités remarqueraient l’affaire et reprocheraient au village de ne pas leur avoir signalé. Malheureusement pour nos villageois, le groupe d’assassins de Sozô provoque une révolte armée un peu plus loin. L’officier shogounal du lieu mène alors une enquête et découvre le pot aux roses : près d’un an après le meurtre, les responsables du village sont donc convoqués à Edo pour un interrogatoire.
Chapitre 2 : Apparition des « coqs de village » (名主)
Ce chapitre décrit essentiellement le village type de l’époque, essentiellement agricole et pauvre, via ses registres fiscaux qui permettent de connaître le nombre d’habitants, son évolution, et la richesse des différents foyers. La description elle-même est très instructive.
Le premier recensement disponible date de 1662. Le village abrite 177 habitants, qui passent à 268 en 1671, puis se stabilisent. Un pic est atteint en 1797 avec 325 habitants, pour redescendre entre 246 et 297 au XIXe siècle, jusqu’au dernier recensement de 1870. Le nombre de foyers fiscaux part de 45 en 1662 pour arriver à 71 en 1797, puis n’augmente quasiment plus (76 en 1870). On remarque qu’à partir de 1823, chaque recensement fait état d’un certain nombre de foyers qui disparaissent : plus d’une dizaine sont dans ce cas en 1856, puis en 1870. Ces foyers pauvres deviennent ensuite des groupes de vagabonds et sont expulsés du village : c’est le signe d’un déclassement, d’une relégation à un état inférieur, dans la zone grise de la société, hors du champ officiel, presque hors de l’humanité (on le remarque avec le vagabond assassiné : son assassinat ne pose de problème à personne).
En 1797, le nombre moyen d’habitants par foyer est de 4,5 personnes seulement ! Cela signifie que la moyenne de naissance par maison est a priori en-dessous de deux, sans compter que sur ces 4,5 personnes, on peut inclure père et mère, mais aussi éventuellement la génération supérieure.
On remarque encore que les réseaux d’alliances entre les maisons « des coqs de village » (dont une des familles impliquées dans l’affaire est un exemple) sont importants, via des adoptions mutuelles, ce qui explique pourquoi on ne cherche pas forcément à faire beaucoup d’enfants (au pire, il suffit d’adopter un enfant de maison alliée pour ne pas perdre le patrimoine).
Chapitre 3 : Le procès à Edo
Six représentants du village, dont le père du logeur illégal, Eisaemon, se retrouvent donc à Edo, dans une auberge assignée pour le procès. Nos sources sont les registres, notes et journaux de Kinsaemon, autre coq du village, convoqué en tant que responsable du village et surveillant des autres convoqués.
Ils arrivent en mars 1850 et restent en tout 189 jours pour trois séjours, jusqu’à la fin de l’affaire en 1852. Tout mouvement exige des laissez-passer et des autorisations du tribunal.
La majeure partie des registres sont en fait des livres de comptes minutieux contenant toutes les dépenses du tribunal, afin de pouvoir en répartir ensuite la charge dans le village (car c’est tout le village, collectivement, qui finance) et prouver quelles dépenses sont faites à quel moment (ce qui est d’ailleurs un sujet de grandes disputes après l’affaire dans le village). Ces comptes permettent de suivre au jour le jour les agissements de Kinsaemon.
On remarque qu’il passe du temps à faire du tourisme au début, en attendant les convocations judiciaires qui tardent à venir. En attendant, les six villageois dépensent, par la force des choses (car ils sont logés d’office à l’auberge, payante évidemment, bien qu’elle est en fait une sorte d’office para-officiel assermenté par les autorités pour contrôler et surveiller les étrangers de la ville).
Kinsaemon copie secrètement le texte de loi majeure de l’époque, 御定書, osadamegaki (rédigé en 1742, compilant les peines et lois à l’usage des officiers shougounaux principaux, et d’usage dans les territoires sous domination des Tokugawa, soit un tiers du territoire nippon de l’époque), qui est censé être inconnu du public, et dont la copie est censée être punie sévèrement (elles sont en fait assez nombreuses et fréquentes). Cette copie est faite dans le but de savoir ce qu’il risque lors et à l’issue du procès : prise en charge de tous les frais, destruction de la maison et risque de faillite pour le village qui risque de devoir emprunter pour payer à la fois l’amende et les frais de procès.
Chapitre 4 : Cadeaux et corruption
Le procès — et les autorisations de revenir au village — traînant, l’on peut dire que seules les dépenses augmentent. Le procès semble paralysé, mais Kinsaemon parvient à jouer sur ses relations, grâce à un lointain parent qui travaille comme domestique chez un important seigneur, justement officier en charge de l’affaire, « pour faire avancer tout cela ». Et c’est à grand renfort d’invitations au bordel et autres restaurants de luxe qu’il parvient à accélérer le dénouement de l’affaire…
Chapitre 5 : Fin de l’affaire
Le jugement final est le suivant : simples peines corporelles pour le père du disparu et peines pécuniaires pour la famille du logeur clandestin et pour les communautés (qui ont étouffé l’affaire), ce qui est un résultat inespéré. Notons que l’amende cumulée du jugement ne vaut que 1 % des frais totaux du procès, qui représentent environ (il existe de nombreuses estimations) 105 000 euros.
Questions en suspens : On aurait aimé connaître les suites de l’affaire principale, liée à des mouvements de révolte par des brigands près du mont Fuji. Une analyse de la procédure et des motivations du procès aurait été instructive. Une tentative de synthèse sur la situation générale des procès au Japon de cette époque aurait aussi permis de mieux placer le procès dans le contexte.
Sources : Sources directes essentiellement : registres fiscaux du village, notes et journal de Chôsaemon, lettres de convocation et divers registres du procès, mais aussi d’autres journaux de lettrés du village où se produit l’affaire.
Enseignements majeurs : L’ordre de fer de l’ère Edo est contourné en pratique par une « subsidiarité » effective. Ainsi, les autorités locales font tout pour étouffer l’affaire traitée dans le livre.
Le village décrit, d’environ 300 habitants, est démographiquement figé pendant toute l’ère Edo, avec un malthusianisme très avancé et une élimination sociale de tous les « marginaux » dans un processus coutumier ancré. Edo est déjà une mégapole très « moderne », mais sans liberté légale. La capitale a déjà posé les fondations du Tokyo actuel en termes de topographie, de tourisme, d’implantations des affaires et des lieux de pouvoir.
À travers le procès, très formel, on ne cherche pas la vérité ou la justice. On recherche seulement les informations susceptibles d’étouffer une révolte potentielle contre le pouvoir légitime et sa nature. Le procès est lent et les témoins du village, forcés de loger dans une auberge assignée, paient, paient et paient encore. Le procès se termine au bout de trois ans à grand renfort de corruption.
Les accusés ne sont pas les coupables, ils sont les responsables des communautés de ces derniers. Ceux-ci sont responsables pénalement même s’ils n’ont pas eux-mêmes commis le crime. En effet, l’ère Edo avait un ordre légal injuste et extrêmement dur. Ainsi, tout le monde admettait le principe du « pas de vagues » (tout faire pour que cela ne remonte pas aux oreilles des puissants, dans le but de maintenir une « harmonie » (« 和 ») sociale). Le riche et le puissant arrivaient toujours à s’en sortir. Le crime politique, lui, était puni durement et sans ménagement. Pas de lois supérieures à la volonté du prince.
Au fond, l’assassinat d’un vagabond (無宿, mushuku, sans logement) n’est pas un problème pour la société japonaise du XIXe siècle. Personne ne se pose la question de faire justice à son encontre, sa vie ne comptant pas, car il est déjà mort socialement, hors de l’humanité ordinaire, et il peut bien mourir, cela importe peu. Pour les gouvernants, seul l’ordre public et l’ordre légal positiviste comptent. Ici, tout est différent de l’ordre chrétien d’Ancien Régime, où tout baptisé est fils de Dieu et temple du Saint Esprit, et où tout non-baptisé a été racheté et a vocation à être sauvé, ce qui exige une justice véritable (rappelons d’ailleurs que, dans tout tribunal, le crucifix était sous les yeux des juges, afin de leur rappeler le procès le plus inique de l’histoire, et leur responsabilité). Ici, en terre païenne, rien de tout cela, il y a les hommes et les sous-hommes, les purs et les impurs, les invisibles, les sans-visage, les sans-nom qui n’existent pour ainsi dire pas, et les imposables, certes exploités, mais faisant partie de l’ordre général.
Paul-Raymond du Lac
Membre de l’Institut Lys et Chrysanthème
et du Cercle d’Études Légitimiste (CEL) de Tokyo
